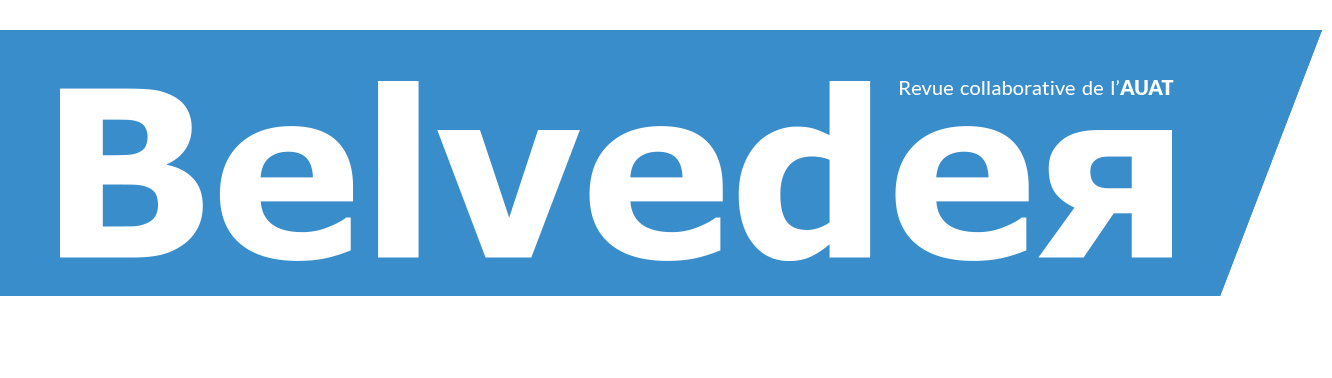Téléchargez l’article au format PDF
Laure Ortiz
Professeure de droit public
Sciences Po Toulouse
Ironie des temps : à l’heure du confinement où j’écris, ne s’attardent plus, sur les avenues désertées de la ville, que des sans-abris, des marginaux et des démunis qu’on s’acharnait à chasser. Isolés ou en groupes, ils continuent à veiller le chaland et à dormir sous les porches et auvents, indifférents aux consignes sanitaires. Roms et migrants ont disparu ; les campements sauvages ont été dispersés alors que les centres d’hébergement sont saturés. Bien avant la pandémie (depuis 1993), pour aseptiser l’espace urbain, de nombreux maires ont mobilisé leur pouvoir de police à coups d’arrêtés « anti » (anti-mendicité ; anti-glanage et chiffonnage ; anti-bivouac ; anti-racolage ; anti-stationnement des gens du voyage ; anti-burkini ; anti-SDF) et d’arrêtés couvre-feux pour mineurs. En mars 2020, la fondation Abbé Pierre classait la ville de Toulouse deuxième après Paris au palmarès du mobilier urbain anti-SDF[1] . Droit à la ville[2], droit à l’habitat[3] , droit au logement[4] : que de vains mots s’ils désignent le privilège de quelques-uns ! Comment le droit peut-il justifier ces politiques de ségrégation de l’espace public urbain ? L’espace public, lieu métaphorique de l’être-ensemble, du faire communauté, est-il encore le support et le garant de libertés publiques et si oui, lesquelles ?
Une ségrégation basée sur une conception de plus en plus extensive de l’ordre public
Il n’existe pas de droit de l’espace public mais une kyrielle de mesures de police générale (maintien de l’ordre public) ou spéciale (environnement, santé, spectacles, manifestations, patrimoine, etc.), circonstanciées et locales qui, en se combinant sans souci de coordination ou de cohérence et au gré des convenances sociales, en redéfinit le sens et l’usage. Limitée à l’origine à la préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques, la police de l’ordre public a vu son champ s’étendre. En intégrant dans ses composantes le respect de la dignité de la personne humaine (lancer de nains), la sauvegarde des valeurs et des principes de la tradition républicaine (affaire Dieudonné) ou ce que la société française considère comme « une condition du vivre ensemble » (interdiction de la dissimulation du visage), la notion d’ordre public absorbe désormais toutes sortes d’intérêts protégés (esthétiques, environnementaux, moraux, etc.) auxquels les libertés individuelles et collectives sont subordonnées. Dès lors, les maires n’ont plus nécessairement à se prévaloir de circonstances particulières de temps et de lieu. Leurs mesures de police n’ont plus à viser les atteintes matérielles aux personnes et aux biens mais peuvent prévenir le trouble « dans les consciences » (burkini, voile islamique). L’ordre public revêt désormais des dimensions matérielles et extérieures, et immatérielles ou «sociétales ». Ne sont plus exclusivement policés les activités réglementées (vente ambulante, circulation motorisée…) et comportements délictueux (ébriété, miction sur la voie publique), mais aussi des activités dépénalisées (mendicité, vagabondage), tolérées (prostitution) ou licites (glanage, chiffonnage) et même de simples attitudes (occupation abusive et prolongée du domaine public[5], en position debout ou allongée[6], dépôt de denrées et de sacs de voyages[7]).
Le règlement pénal de l’exclusion sociale
La répression des usages et des comportements exclus de l’espace public, qui vise des catégories de la population sans jamais les nommer, repose sur une logique simple : la sanction pénale de la violation des arrêtés de police administrative des maires. Mais cette dialectique de l’administratif et du pénal va au-delà. Les arrêtés municipaux ont contribué au retour spectaculaire d’incriminations de comportements spécifiquement liés à l’espace public : mendicité agressive, délit d’exploitation de la mendicité et mise en péril de mineur, occupation de halls d’immeuble[8], racolage passif[9], délit d’entrave à la circulation[10],incrimination du fait de se trouver aux abords d’une manifestation illicite[11]. Ils participent à ce que Diane Roman appelle « la gestion pénale de la question sociale »[12]. Face à ces mesures extensives de police, les juges rechignent à reconnaître des droits et des libertés d’usage de l’espace public. Ce mouvement répressif n’est rendu possible qu’en raison de la dissociation croissante des notions d’espace public et de libertés publiques.
Un espace public vidé des droits fondamentaux dont il est le support
Il n’existe pas de droit de l’espace public, disions-nous ; il n’existe pas davantage un droit à l’espace public. Pourtant, les deux notions sont apparemment étroitement liées. L’espace public est la condition sine qua non de diverses libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, de manifestation, de réunion. Il est aussi, pour les plus démunis et les sans-abris, la condition du droit de vivre, de survivre. Or, on cherchera en vain l’énoncé « d’un droit à l’espace public » ou « d’une liberté de persister dans son existence » dans l’espace public. Au mieux, les juges sanctionnent-ils les arrêtés municipaux rédigés dans des termes d’une généralité excessive. Lorsqu’ils le font, c’est en se plaçant sur le terrain de la liberté d’aller et de venir[13]. Cependant, la plupart des jugements ne prennent pas la peine de se prononcer sur la ou les libertés mises en cause”[14]. Pire, ils ont pu, comme la cour administrative d’appel de Douai[15], juger contraire à l’ordre public le fait de considérer la collecte des déchets comme partie intégrante d’un mode de vie (en l’occurrence des Roms) et récuser que le glanage constitue l’exercice d’une liberté d’utilisation de la voie publique ou des choses qui y sont abandonnées. Aucune juridiction n’a reconnu le droit de mendier, de quêter ou de faire l’aumône. Et même lorsque certains juges ont fait preuve d’innovation, comme le tribunal administratif de Besançon[16] découvrant l’existence de la liberté fondamentale d’aider autrui dans un but humanitaire, explicitement dérivée du principe de fraternité, ils concluent que cela n’implique aucune liberté de mendier et que l’atteinte portée en l’occurrence à fraternité, n’est ni suffisamment grave, ni manifestement illégale[17].
En conclusion, la place que le droit réserve aux exclus dans l’espace public, c’est la justification croissante des arguments de leur exclusion. Face à cette situation, le premier geste barrière est de garder à l’esprit que l’espace public et la normalisation dont il est l’objet ne sont que le résultat d’une coproduction sociale à laquelle nous participons tous, chacun et chacune, au premier regard, au premier contact avec une main souillée qui nous réclame l’obole.
[1] La Dépêche du Midi du 09/03/2020.
[2] Loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991.
[3] Loi Quillot du 22 juin 1982.
[4] Loi du 6 juillet 1989 ; rendu « droit au logement opposable » par la loi du 5 mars 2007, dite « loi Dalo ».
[5] Arrêté du maire de Nice suspendu par le tribunal administratif le 14 novembre 2014.
[6] Arrêté du maire de Besançon du 8 août 2018.
[7] Arrêté du maire de Montpellier du 24 mai 1993.
[8] L’article L. 126-3 du Code de la construction et de ’habitation.
[9] Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. L. 225-10-1 du Code pénal.
[10] Article L412-1 du Code de la route.
[11] Le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 (dit « anti-cagoule »).
[12] Diane Roman, « Les sans-abri et l’ordre public », RDSS, 2007, p 952-964.
[13] Ainsi à propos de l’arrêté anti-bivouac du maire de Nice de 2013.
[14] Cour administrative d’appel de Lyon, 6 avril 2017, n° 16LY03766, à propos d’un arrêté anti-mendicité du maire de Roanne de 2014.
[15] Cour administrative d’appel de Douai, arrêt du 5 juillet 2016 à propos de l’arrêté anti-glanage/chiffonnage du maire de La Madeleine interdisant, sans limitation de durée, la fouille des poubelles sur le territoire de la commune ; validé par le Conseil d’État, arrêt du15 novembre 2017.
[16] Cour administrative d’appel de Douai, 5 juillet 2016, et Conseil d’État, 15 novembre 2017, commune de La Madeleine.
[17] Ordonnance de référé du tribunal administratif de Besançon n° 1801454 du 28 août 2018.